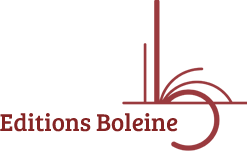Comment l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme a-t-elle évolué depuis sa ratification par la France ?
La CEDH s'applique depuis désormais 50 ans en France et a pris en un demi siècle une importance considérable. Si à l'origine la Cour avait une lecture plutôt prudente et subsidiaire de la Convention, il apparaît désormais que le Juge européen se permet une interprétation de plus en plus dynamique et extensive, qui est de plus en plus perçue comme intrusive par les États ayant adhéré au traité. La Cour s'est progressivement érigée en acteur central de la régulation juridique en Europe, au point de redessiner des équilibres constitutionnels internes.
Quels sont les principaux risques liés à cette évolution jurisprudentielle ?
Il ne s'agit désormais plus de risques, mais de conséquences palpables. Les majeures sont, selon moi, l’uniformisation des droits à marche forcée, la dilution des spécificités nationales et le sentiment d’une justice déconnectée des peuples européens. À force de vouloir tout harmoniser et moraliser, les juges de la CEDH ont réussi à fragiliser l’adhésion même des citoyens au projet européen des droits de l’homme.
Faut-il repenser le rôle de la CEDH aujourd'hui ?
Oui, il est temps d’ouvrir un débat apaisé et exigeant - et c'est d'ailleurs l'objectif de cet ouvrage. Pour autant, il ne s’agit ni de déconstruire ni de sanctuariser, mais d’interroger avec lucidité les dérives, de renforcer la légitimité démocratique de la Cour, et de replacer les États et les citoyens au cœur du dispositif.